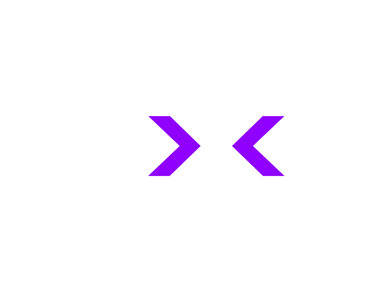Yasser Arafat
De la lutte armée à la diplomatie, une vie de combat pour la Palestine
7/4/20255 min temps de lecture


Enfance et avènement d’un leader
Yasser Arafat naît le 24 août 1929 au Caire. Sa famille est originaire de Jenin, en Cisjordanie. Il perd sa mère à l’âge de 4 ans. Toute son enfance, il voyage entre Jérusalem et le Caire. En 1956, il obtient un diplôme d’ingénieur civil à l’université du Caire.
Dès l'âge de 17 ans, il s’engage pour soutenir la résistance palestinienne. Il aide à faire passer des armes à Gaza et forge très tôt un idéal nationaliste. Il croit que seule la lutte armée peut libérer la Palestine.
En 1959, il fonde le Fatah, un groupe clandestin qui prône la libération de la Palestine par les armes. Dix ans plus tard, en 1969, il devient président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Cette organisation rassemble différents mouvements nationalistes palestiniens. En 1974, la Ligue arabe et l’ONU reconnaissent l’OLP comme le représentant légitime du peuple palestinien. Elle devient leur voix politique dans le monde et Arafat le visage de la résistance palestinienne. Cette même année, Arafat prononce un discours historique devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.
« Je suis venu avec un rameau d’olivier dans une main et un fusil de combattant dans l’autre. Ne laissez pas tomber le rameau d’olivier de ma main. »
Yasser Arafat 1974 Assemblée générale des Nations Unies
Depuis ses bases en Jordanie, puis au Liban et enfin en exil à Tunis, Arafat dirige la lutte à distance. Il reste la figure centrale de la cause palestinienne. Mais la Première Intifada, en 1987, change la donne.
Le 13 décembre 1988, à Genève, il reconnaît officiellement l’État d’Israël, renonce à la violence et proclame l’État de Palestine. Cet État sera reconnu par plus de 100 pays, mais pas par l’ONU, faute de consensus.
Sur le plan personnel, il épouse en 1990 Suha Tawil, une Palestinienne chrétienne de Ramallah. Leur fille Zahwa naît en 1995. Arafat tient sa vie familiale à l’écart de la scène politique.

De la guerre à la négociation – Les Accords d’Oslo (1993–2000)
Les Accords d’Oslo sont signés en 1993 à Washington entre l’OLP et Israël. Les signataires sont Yasser Arafat, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, sous la médiation du président américain Bill Clinton. L’accord marque une reconnaissance mutuelle. L’OLP reconnaît l’existence de l’État d’Israël, et Israël reconnaît l’OLP comme représentante légitime du peuple palestinien.
L’accord prévoit aussi la création d’une Autorité palestinienne, censée gouverner les territoires palestiniens. Un transfert progressif de souveraineté est engagé : Israël doit céder à cette Autorité le contrôle civil et sécuritaire sur certaines zones de Cisjordanie et Gaza, en commençant par les villes les plus peuplées.
En 1994, Arafat, Rabin et Peres reçoivent le prix Nobel de la paix. Deux ans plus tard, en 1996, Arafat devient président élu de l’Autorité palestinienne. Mais le processus déraille. Le 4 novembre 1995, Yitzhak Rabin est assassiné à Tel-Aviv de trois balles dans le dos, par Yigal Amir, un ultranationaliste israélien opposé aux Accords d’Oslo. Pour lui, céder des terres aux Palestiniens était une trahison.
En 1996, Benjamin Netanyahu, du parti de droite Likoud, arrive au pouvoir. Il freine le processus d’Oslo. Il refuse le principe de retrait total des territoires occupés, continue la colonisation, et bloque les négociations. En juillet 2000, des pourparlers de la dernière chance sont organisés à Camp David, aux États-Unis. Ils réunissent Arafat, Ehud Barak (Premier ministre israélien) et Clinton. Mais les discussions échouent. Les deux camps se rejettent la faute. Aucun accord n’est signé. Trois mois plus tard, c’est l’explosion. La Seconde Intifada commence. Elle entérine l’échec d’Oslo.

Dernières années, mort mystérieuse et controverses (2000–aujourd’hui)
Yasser Arafat est passé plusieurs fois près de la mort. En 1992, il survit à un crash d’avion en Libye. En 2002, pendant l’opération israélienne « Rempart », il est assiégé dans son QG de la Mouqataa, à Ramallah. L’armée israélienne entoure le bâtiment. Arafat y reste cloîtré plus d’un an et demi, affaibli et isolé. À l’époque, Sharon accuse Arafat d’être un obstacle à la paix, et Bush, sans le dire explicitement, soutient cette vision. D’après Uri Dan, confident et biographe d’Ariel Sharon, un échange marquant a eu lieu entre ce dernier et George W. Bush. Le président américain aurait dit à Sharon : « Laissez le destin d’Arafat entre les mains de Dieu. » Ce à quoi Sharon aurait répondu froidement « Parfois, Dieu a besoin d’un coup de main. ».
En 2011, des extraits des Palestinian Papers révèlent une lettre datée du 13 juillet 2003. Son auteur : Mohammed Dahlan, puissant responsable sécuritaire palestinien. Il écrit au ministre israélien Shaul Mofaz : « Soyez certain que les jours de Yasser Arafat sont comptés, mais laissez-nous en finir avec lui à notre manière, pas à la vôtre [...] je donnerai ma vie pour tenir les promesses que j’ai faites devant le président Bush. »
La lettre n’a jamais été démentie. Face au scandale, Dahlan quitte ses fonctions puis s’exile.
En octobre 2004, Arafat tombe gravement malade. Il vomit, a la peau jaune, ses reins lâchent. Dans la nuit du 2 au 3 novembre, ses proches demandent à Israël un antidote d’urgence. Il est évacué à l’hôpital militaire Percy, en France, où il meurt le 11 novembre. Aucun diagnostic clair n’est rendu public. Aucune autopsie n’est pratiquée.
Huit ans plus tard, en 2012, sa dépouille est exhumée. Des échantillons sont envoyés à trois laboratoires : 5 aux Français, 16 aux Suisses, 25 aux Russes. Si Arafat a été empoisonné 8 ans plus tôt, la quantité de poison dans son corps pourrait avoir diminuée voire disparue. Le polonium-210 a une demi-vie de 138 jours, ce qui signifie qu'il resterait une quantité infime de la substance (divisée par 2 millions).
Les résultats sont contrastés. Les Suisses trouvent la dose la plus forte : 900 millibecquerels sur un fragment d’os iliaque. Selon eux, un empoisonnement est « plausible », mais pas certain. Ils estiment la probabilité à 0,5. Les Français concluent à une mort naturelle, sans publier leurs données. Les Russes, dans un premier temps ouverts à l’hypothèse criminelle, changent de position dans leur rapport final de décembre 2013. D’après un journaliste interrogé par Clayton Swisher, le ministère des Affaires étrangères, dirigé par Sergueï Lavrov aurait relu et en partie réécrit les conclusions officielles. Entre la version confidentielle et celle publiée, plusieurs passages auraient été supprimés.
Le mystère reste entier. Vingt ans après, aucun tribunal, aucune enquête internationale, n’a pu établir clairement les causes de la mort d’Arafat. Il reste à ce jour la figure emblématique de la cause palestinienne. Malgré la dureté de son combat, il n’a jamais perdu son humour ni jamais lâché son kéfié.